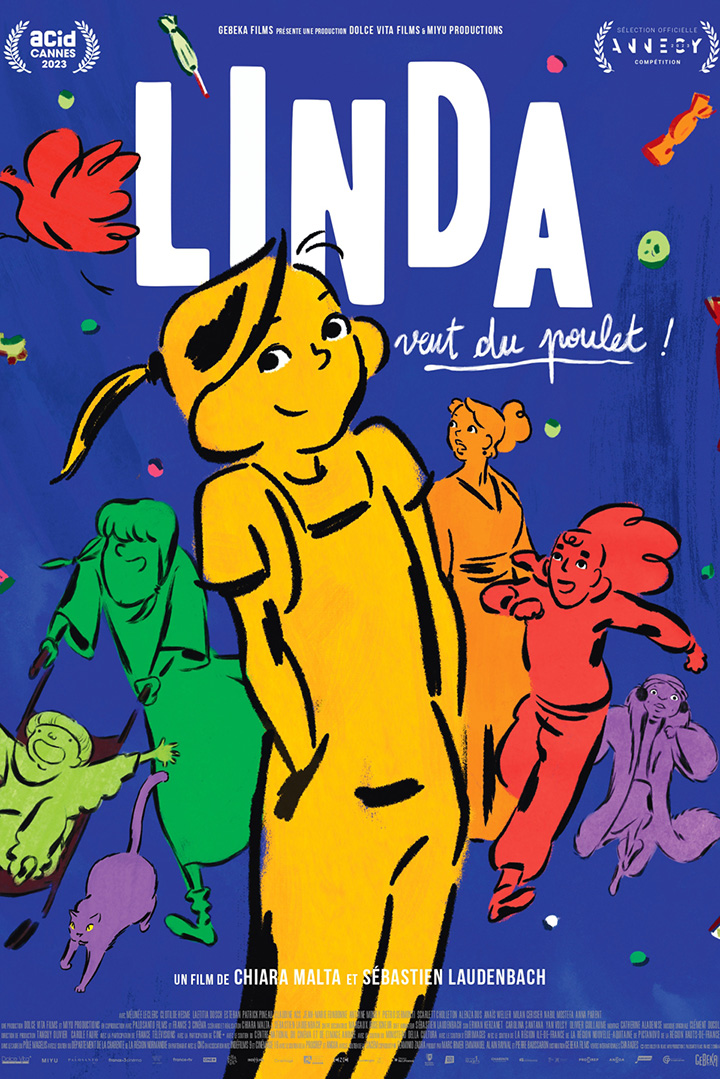Le Pier + Entre elle et moi + Le père idéal
La cinéaste a obtenu en 2022 la plus haute distinction décernée à un cinéaste québécois. À cette occasion la Cinémathèque québécoise tenait à souligner la contribution de l'une des pionnières du cinéma indépendant et du cinéma au féminin. Nous présentons quelques films rares, dont des versions restaurées par la Cinémathèque québécoise dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec.
Un essai cinématographique, partant d’images que la cinéaste a filmé au cours des années entremêlées d’archives familiales datant des années 40, toutes tournées au même endroit, sur la même plage d’Old Orchard, Maine, USA. Un film où les personnages des archives se transforment en acteurs principaux.
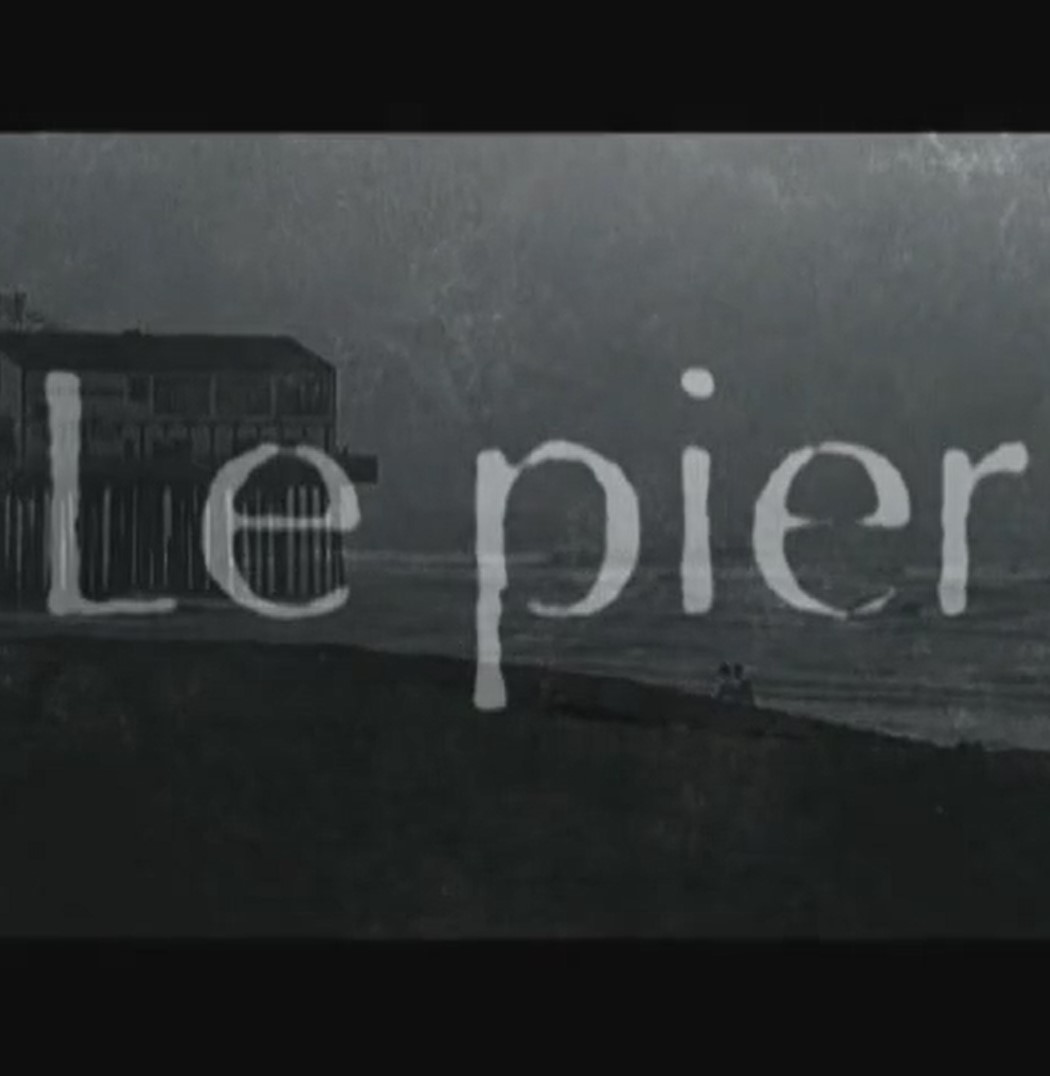
Madeleine Dansereau fut la première femme joaillière au Québec. Elle commença sa carrière à 47 ans, au moment même où les médecins la condamnaient à cause d’un cancer du sein. Sa contribution la plus connue est sans doute l’emblème de l’Ordre National du Québec. Sa fille Mireille, cinéaste, évoque leur relation durant les vingt dernières années tout en gardant comme toile de fond son itinéraire cinématographique.

Un entrepreneur d'une quarantaine d'années est interrogé par son entourage, sa femme, son amant, ses enfants et son ami. Tous le jugent, attendant de lui quelque chose de différent, en particulier son fils qui se montre dur et sans pitié à son égard.

Mireille Dansereau
Mireille Dansereau naît à Montréal en 1943, et grandit dans un milieu bourgeois qui sera une source d’inspiration dans son œuvre à venir. Elle étudie la danse et les lettres tout en se passionnant pour le cinéma. Elle débute sa carrière avec des petits contrats à l’ONF, où elle réalise son premier court métrage en 1967, Moi, un jour. Dans le cadre de sa maîtrise en cinéma au Royal College of Arts de Londres, elle réalise deux longs métrages, Compromise et Forum. Mais c’est à son retour à Montréal que la jeune cinéaste tourne le film qui lance véritablement sa carrière : La vie rêvée, en 1972. Elle y aborde déjà la condition féminine, thème central de sa filmographie, qu’elle explore par la suite dans des documentaires réalisés à l’ONF sous l’impulsion d’Anne Claire Poirier, puis à travers deux films de fiction remarqués, L’arrache cœur et Le sourd dans la ville. À partir des années 1990, la forme de l’essai lui permet d’explorer les relations familiales tout en continuant d’affirmer son regard au féminin dans le paysage cinématographique québécois.